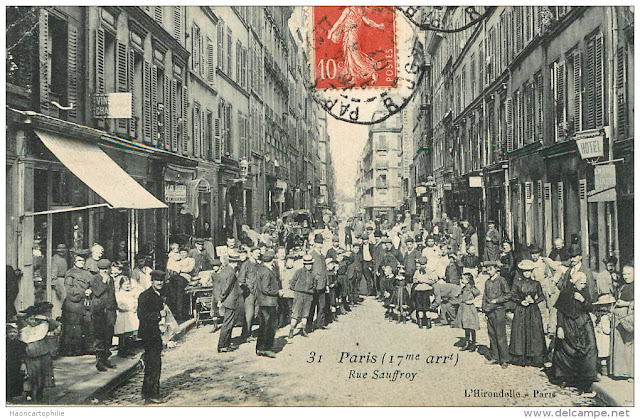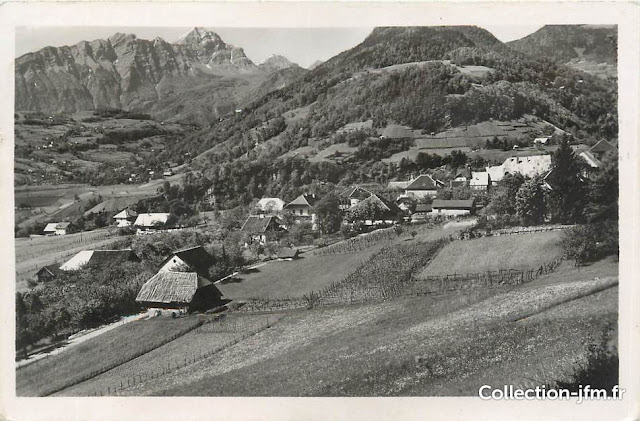Après le mariage de Joseph
Jaquin [140] et Claudine Cohendet-Chapot [141] (
cliquez-ici), je m'intéresse aujourd'hui au décès du père de Claudine, Claude Cohendet-Chapot, grâce à un document particulièrement intéressant, son inventaire après décès.
 |
| Sépulture de Claude Cohendet-Chapot, le 10 mars 1741, dans les registres paroissiaux de Venthon (Savoie) |
Le 8 mars 1741, Claude
Cohendet-Chapot [282] meurt dans sa maison de Venthon, en Savoie.
Nous ne connaissons pas sa date de naissance, mais il devait avoir
une trentaine d'années. Il s'était marié le 25 février 1734 avec
Anne Deschamps-Bonnat [283] de la paroisse voisine de Conflans
(aujourd'hui, incorporée à Albertville). Au moment de son décès,
ils ont deux enfants : Claudine, née le 13 mars 1737 et Joseph
né le 2 novembre 1739. Comme il était d'usage lorsqu’un défunt
laissait des enfants mineurs, il était procédé à un inventaire
des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, afin de garantir les droits
des héritiers jusqu'à leur majorité. En effet, dans le cadre du
régime dotal, si l'épouse restait propriétaire de sa dot, elle
n'avait pas de droits particuliers sur l'héritage de son mari, qui
revenait à ses enfants. En tant que tutrice, elle était donc
responsable de leur préserver cet héritage jusqu'à leur majorité.
À leur majorité, les enfants devaient lui donner quittance de sa
gestion de leurs biens. Dans ces conditions, l'inventaire du défunt
permettait de garantir une « image » fidèle de tous les
biens dont la tutrice serait plus tard comptable.
Ainsi, dès le 8 mars,
le notaire Claude Antoine Viallet, de Conflans, vient poser les
scellés, les « cachettement » comme l'indique l'acte. Le
10 mars, Claude Cohendet-Chapot est inhumé. Le 16 mars, le notaire
se présente à la maison des « hoirs [héritiers] de feu
Claude Cohendet Chappot » pour procéder « à inventaire
des effets, titres, meubles, créances et autres délaissés par
ledit feu Claude Cohendet Chappot ». L'inventaire va durer deux
jours, les 16 et 17 mars. Sont présents la veuve, Anne
Deschamps-Bonnat, son frère Jean François Deschamps-Bonnat qui se
porte caution pour sa sœur, et cinq témoins, tous de Venthon :
Antoine Roengier-Monet, oncle maternel du décédé, Louis
Hivert-Besson, son beau-frère, Joseph Girondet-Ramboud, Joseph
Sibuet et Antoine Gindrat.
C'est cet inventaire
que nous allons analyser. Il contient trois parties : les
meubles, les titres, autrement dit tous les papiers du défunt, et
enfin les biens immobiliers. Comme il s'agit de l'inventaire de
Claude Cohendet-Chapot, tout ce qui pouvait appartenir à sa veuve
n'est pas inventorié, même s'il y est parfois fait référence.
La maison du défunt
est composée d'une cuisine, qui est la pièce principale, et d'une
cave, le tout surmonté d'un grenier et d'un « galletaz ».
À côté de la cuisine, se trouve une écurie – une « equirie »
comme l'orthographie le notaire. Il semble qu'il y avait aussi une
grange, qui est peut-être confondue avec le grenier. La maison est
couverte de paille, autrement dit de chaume. Le notaire, avec les
témoins, passe dans chaque pièce et relève tous les objets, en
donnant, pour chacun, une estimation de sa valeur, qualitativement,
ou de son usure.
Dans la cuisine, il ne
trouve que trois meubles : deux lits en sapin et un « mauvais »
coffre en sapin avec une serrure.
Comme ustensiles de
cuisine, il inventorie :
Deux pots à feu
« de guise » (en fonte) d'une contenance de 4 pots, soit
6 litres chacun.
Deux marmites de
cuivre, d'une contenance d'environ un demi-seau.
Un pot, un
demi-pot et deux cuillères en étain.
Une tasse à
puiser l'eau, deux cuillères à pot, deux poêles à frire.
Deux seaux de
bois.
Une crémaillère,
deux petits chenets, une poêle à feu.
Une poêle à
frire percée.
Une lampe de
métal.
S'il ne relève aucune
nourriture, qui est conservée au grenier, il trouve dix livres (à
peu près 4 kg) de « fillet de rite », autrement dit des
écheveaux de fibre de chanvre tissée et douze livres (à peu près
5 kilos) de « fillet d'etoupe », soit de la fibre de
chanvre non tissée.
Enfin, dans cette
pièce, Claude Cohendet-Chapot conserve son fusil.
La cuisine était la
pièce principale de la maison, celle dans laquelle toute la famille
vivait, mangeait, recevait et dormait. C'était la seule pièce aussi
dans laquelle se trouvait une cheminée, qui permettait en même
temps de faire la cuisine, grâce aux marmites, attachées à la
crémaillère, et aux poêles, et de se procurer un peu de chaleur en
hiver. La description de la maison laisse penser que l’écurie est
distincte de la cuisine, autrement dit qu'il n'y avait pas de
cohabitation des hommes et des animaux, comme on le voit dans de
nombreux autres villages de montagne dans les Alpes.
 |
| Cette image d'un intérieur savoyard, largement postérieure et quelque peu caricaturale, donne une idée de l'utilisation de la cheminée pour la cuisine et le chauffage. Dans cet intérieur, les animaux cohabitent avec la famille. |
Le reste des biens se
trouve au grenier, situé au-dessus. Il n'est pas précisé comment
on y accède, mais il devait probablement y avoir un escalier
extérieur. Il y a là les deux coffres de la famille, le meuble de
rangement par excellence. Il y a le coffre en sapin, avec ses
ferrures et serrures, dans lequel Claude Cohendet-Chapot conserve ses
titres et papiers qui sont inventoriés par le notaire, puis le
coffre en sapin avec ses ferrures et serrures fermant à clef, qui a
été donné à Anne Deschamps-Bonnat par son frère Jean François,
probablement au moment de son mariage, comme élément de la dot, et qui contient les habits de
la famille, dont les habits qui ont formé le trousseau de la veuve.
Comme expliqué, ce dernier ne sera pas inventorié.
Toujours au grenier, comme seuls meubles, il y a
une table en noyer, avec son « soutien », probablement le
pied de table, et trois chaises, aussi en noyer. Enfin, il n'y a qu'un seul ustensile
de cuisine, une « mauvaise » poêle à frire, qui
était probablement là car elle n'était plus utilisée. On y trouve
aussi « un poid à crochet sans coupe tirant du costé du plus
quarante sept livres et de l'autre douze livres », que
j'identifie comme une balance romaine, permettant de peser de 5 à 20
kilos (la livre de Savoie valait 418,61 grammes).
C'est aussi au grenier
que la famille conserve ses provisions. Dans un grand coffre en
sapin, appelé « arche », qui servait à conserver le
grain dans des compartiments, le tout mesurant 9 pieds de longueur et
4 de largeur, soit 3 mètres sur 1,30 mètre, à 3 niveaux, le
notaire inventorie 30 « cartes » de seigle et 12
« cartes » d'avoine, soit 4 hectolitres de seigle et 1,6
hectolitre d'avoine. Le « carte », ou « quarte »,
est une mesure de volume savoyarde. Sur une « terrasse »
(une étagère ?), il y a aussi deux pots d'huile de noix, deux
moitiés de lard de cochon et quatre jambons. Enfin, le notaire
trouve une « carte » et demi, soit 20 litres, d'orge
réservés pour l'ensemencement. Nous en reparlerons.
Le grenier abrite aussi
quelques outils agricoles : deux faux, deux haches, dont une
grosse hache appelée « pioule », un coin de fer, pour
fendre le bois et, enfin, un coutre avec un soc en fer servant de
charrue, pour labourer. Pour finir, la famille range là les deux
tours à filer, nécessaires pour le filage domestique du chanvre.
Les tours à filer faisaient parfois partie de la dot de la jeune
fille, puisque le travail des fibres était une tâche dévolue aux
femmes.
Nous avons bientôt
fini de faire le tour de la maison. Dans la cave, le notaire
inventorie quatre tonneaux de bois, dont certains sont cerclés de
fer, un cuvier, trois cornues (voir en fin de message) et comme outils agricoles, un
« tridant » (une fourche), et une herse. Devant la cave,
se trouve une cuve dont le notaire rapporte qu'il faut refaire le
fond.
Voilà tous les biens
de la famille.
On peut seulement
s'étonner de ne trouver aucune assiette, ni aucun couvert, hormis
quelques cuillères. Il est fort probable que l'on mangeait
directement dans les marmites ou pots, avec les cuillères. La
cuisine se faisait directement dans la cheminée, dans les marmites
qui étaient accrochées à la crémaillère. On constate donc une
certaine rusticité de mœurs et d'usages. On remarque aussi qu'il n'y
a aucun siège dans la cuisine, qui était pourtant le lieu de vie,
où l'on mangeait, dormait et vivait. Le coffre pouvait servir de
siège. Peut-être qu'il y avait des murets le long du mur pour
s'asseoir. La table et les sièges remisés au grenier ne devaient
guère servir et, surtout ne devaient pas servir à un usage
quotidien. Il faut toujours avoir à l'esprit que les intérieurs
paysans « anciens » tels qu'on peut les voir dans les
musées régionaux, les musées de la vie rurale, dans les films et,
plus généralement, dans l'imagerie de la vie d'antan, reflètent en
réalité un état de ces intérieurs tels qu'ils étaient à la fin
du XIXe siècle, et non ceux du début XIXe et encore moins du XVIIIe
siècle. A ma connaissance, il n'existe pas de vues d'intérieurs
paysans savoyards, que ce soit ceux des paysans « moyens »
comme l'étaient Claude Cohendet-Chapot et sa famille ou de paysans
plus aisés ou de bourgeois de village. Seuls ces inventaires peuvent
nous en donner un aperçu. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas
déduire de ce très grand dépouillement de l'intérieur de ces
maisons que nous avons affaire à une famille pauvre.
Le linge de la famille
est tout aussi modeste. Parmi le linge de ménage, le notaire
inventorie douze draps de toile commune, trois nappes de toile
commune, trois serviettes et une « couverte » (une
couverture) de drap gris.
Quant aux habits du
défunt, il se résume à huit chemises, une veste de draps, une
veste de toile à drap, un corsage de toile à drap, un corsage de
ratine, une paire de culotte de ratine bleue, une autre paire de
culotte de toile à drap, trois cravates de toile de marchand. Pour
se couvrir, Claude Cohendet-Chapot a deux chapeaux. Le « corsage »
doit être un gilet. Quant aux culottes, c'était l'habit habituel
des hommes. Le notaire ne relève aucun bas, qui était le complément
de la culotte. Pour se faire une idée de la cravate, cette
définition du Dictionnaire de l'Académie française de 1694
décrit ce qu'était la cravate à cette époque : « Sorte de mouchoir fait de toile ou de taffetas qui entoure le col, et
tient lieu de collet. » On était alors plus proche de
l'écharpe que de la cravate que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, dans cette région,
l'usage était plutôt de porter des chaussures que des sabots.
Pourtant, dans cet inventaire, il n'y en a aucune. Peut-être que le
défunt a été enterré avec la seule paire de chaussures qu'il
possédait.
 |
| Image, probablement enjolivée, du costume des paysans d'Allevard, qui nous donne, néanmoins, une idée du costume masculin au XVIIIe siècle (source : Les anciens costumes des Alpes du Dauphiné, Edmond Delay, 1922). |
Cette autre image, datée de 1804, est peut-être plus proche de l'habillement ordinaire. Comme dans l'inventaire des habits de Claude Cohendet-Chapot, l'homme porte une veste et une culotte en drap, un gilet bleu (un « corsage »), une cravate blanche et une large ceinture rouge. Il porte des bas et des guêtres. Il est coiffé d'un tricorne, comme, peut-être, en portait notre ancêtre.

Comme toutes les
familles de petit paysan et petit propriétaire de cette région, la
famille Cohendet-Chapot combinait la culture céréalière :
seigle, avoine et orge, et un peu d'élevage. Dans l'écurie de la
maison, Me Viallet trouve quatre vaches, dont deux appartiennent à
la veuve Anne Deschamps-Bonnat. L'âge des vaches est donné en
« veaux ». Une des vaches est âgée de « cinq
veaux », et les autres de « neuf veaux ». A côté
de ces vaches, le notaire relève deux veaux de deux ans, six brebis,
dont il précise que ce sont des agneaux d'une année et enfin un
« petit chochon » qu'il qualifie de « hivernage »
si ma lecture est correcte. Il doit s'agir du cochon que la famille
engraisse pendant l'hiver, pour ensuite être tué à l'automne
suivant afin de fournir le lard et le jambon, sous forme de salaison, comme ceux qu'ils
conservent dans le grenier.
Dans un des coffres du
grenier, la famille conserve précieusement les différents papiers
de famille : contrats de mariage, testaments, obligations,
quittances, contrat de vente, etc. Dans ce pays de droit écrit, ces
documents étaient la preuve tangible de l'histoire patrimoniale de
la famille. Il n'y a pas moins de 29 ensembles de documents,
contenant de une à cinq pièces. Le plus ancien est un « contrat
de ratification portant relachement d'un quarteron de terre pour
Nicolas Jacquin, de Venthon, par Mauris Ducretet Payez, du mandement
de Chatel », de 1668, soit 73 ans auparavant. Ce Nicolas
Jacquin apparaît plusieurs fois parmi les papiers, sans que l'on
sache à quel titre. Si le notaire a répertorié cet acte, c'est
qu'il devait avoir une importance pour l'histoire patrimoniale de
Claude Cohendet-Chapot, à la différence de ces autres documents
qu'il se contente de rassembler dans « une liasse où sont
contenus tous les papiers de nulle valeur ». L'ensemble de ces
papiers montre que ces ménages vivaient dans une économie de la
dette où chacun devait de l'argent en même temps qu'il lui en était
dû, d'où ces quittances nombreuses qui sont la preuve que les
dettes ont été payées ou que les sommes sont encore dues. La
situation financière de Claude Cohendet-Chapot semble avoir été
assez saine car il meurt sans dettes, ni créances.
La dernière partie de
l'inventaire, tout aussi instructive pour nous, est la description
détaillée de toutes ses propriétés foncières, sur la base du
cadastre de Venthon. A la différence de beaucoup de régions
françaises, la Savoie, alors hors du royaume de France, disposait
déjà d'un cadastre dès le XVIIIe siècle, basé sur de très
belles cartes qui représentaient de façon colorée et précise le
découpage des terroirs entre les champs, les bois, les vignes, les
habitations, les chemins et, plus généralement, tous les détails
du paysage. Associé à ces « mappes », car tel était le
nom de ces cartes, le cadastre en lui-même référençait toutes les
propriétés des personnes. Parmi les papiers inventoriés, il y a
une copie du cadastre pour Antoine Cohendet-Chapot, le père de
Claude, datée de 1733. C'est probablement sur la base de ce document
que le notaire inventorie les propriétés de Claude Cohendet-Chapot.
Pour illustrer la précision de la description des parcelles, cet extrait :

Transcription :
Item champ aud.
contenant suivant led. cadastre quatre journaux trois cent
huittante six toises
cinq pieds et sous le numero d'icelluy deux cent vint quatre et le
tout
se confine par les
champs de jean baptiste ducretet payaz dessus le susd. chemin
tendant de venthon au
pomarey dessous et pré des hoirs de me benoist marin champ
d'antoine roengier
monet pré dud. loüis deschamps bounat et champ de jaque vouthier
du levant champ des
hoirs dud. me. benoist marin du couchant
La surface de la
parcelle est exprimée en journal, toise et pied, qui sont les unités
de mesure de surface en Savoie. Le journal valait 29 ares 48 m2,
400 toises faisaient un journal et 8 pieds faisaient une toise. Cette
parcelle mesure donc 1 hectare 46 ares et 41 m². Le notaire décrit précisément les confins, autrement dit les propriétés mitoyennes, avec leurs propriétaires, selon les 4 points cardinaux : nord (« dessus »), sud (« dessous », est (« levant ») et ouest (« couchant »). Cette parcelle se trouve sur la « mappe », au quartier aujourd'hui appelé Poirier Rousset :

La parcelle 222,
insérée dans la parcelle 224, appartient aussi à Claude
Cohendet-Chapot. Elle est qualifiée de pré. On remarque que la
convention de représentation des champs est une évocation d'un
terrain labouré, avec ses sillons, alors que le pré est une surface
verte. Sur cette parcelle 224 se trouve une petite construction, en
rouge, qui appartient aussi à Claude Cohendet-Chapot. Dans
l'inventaire, ce bâtiment est qualifié de grange, d'une surface de
143 m². C'est un petit bâtiment comportant au rez-de-chaussée une
écurie, surmontée d'une grange, le tout étant couvert de paille,
autrement dit de chaume. Ces petits bâtiments agricoles, qui
semblent nombreux sur le territoire de la commune, permettaient de
garder les récoltes, les outils et le bétail proches des champs et
des prés. Dans le cas présent, cette grange ne se trouve qu'à 400
m. de la maison familiale, à vol d'oiseau. Si, au moment du décès
de Claude Cohendet-Chapot, cette écurie et cette grange contenaient
des biens, ils ne sont pas inventoriés.
En définitive, sur la
commune de Venthon, Claude Cohendet-Chapot possédait 13 parcelles,
qui totalisaient 4 hectares 31 ares. Il y avait une variété de
terres : des champs, qui sont des terres labourables, des près,
pour le pâturage du bétail, des vergers, proches des maisons, et
des bois de châtaignier. Ainsi, cette variété permettait à la
famille d'assurer sa subsistance, en lui fournissant tous les
aliments dont elle avait besoin : seigle, pour le pain, avoine,
orge, laitages, fournis par les vaches, viande de porc, châtaignes,
fruits et probablement légumes. Les parcelles plantées de
châtaigniers offraient du bois de chauffage, outre le complément
alimentaire fourni par les châtaignes. Ce bois était indispensable
pour assurer la cuisine quotidienne et la chaleur en hiver, d'autant
que la description de la maison laisse penser qu'il n'y avait pas de
cohabitation des hommes et des animaux dans une même pièce en
hiver, comme on le voit fréquemment dans d'autres régions de
montagne. La découpe du bois de chauffage était une activité
importante, comme on l'a vu par la possession de deux haches et d'un
coin de fer, parmi les rares outils agricoles que possédait Claude
Cohendet-Chapot.
Pour compléter
l’approvisionnement de la maison, la famille possédait une
parcelle de vigne de 850 m², à « Plambety » (Plan
Betet), sur la commune voisine de Conflans, sur un coteau surplombant
la vallée de l'Isère, exposé à l'ouest. Claude Cohendet-Chapot
pouvait ainsi faire sa « piquette ».
 |
| Les vignes de Conflans |
Comme beaucoup de
paysans de Venthon, Claude Cohendet-Chapot possédait sa maison
d'habitation. Cependant, il se distinguait en possédant une deuxième
maison, proche de la première, composée d'une cuisine, d'une
écurie, d'un galetas et d'une petite cave, le tout d'une surface de
100 m². Enfin, en plus de la grange citée ci-dessus, il en
possédait une autre sur un autre terroir de la commune, proche de
cette deuxième maison.
 |
| Sur ces deux vues : « mappe » de 1732 et photo aérienne (source : Géoportail), on constate que la trame des rues est restée inchangée, même si de nombreuses rues ont été élargies. La maison Chapot est entourée d'un cercle blanc. En bas à gauche, le cimetière, où sont enterrés nos ancêtres Joseph Barféty et Joséphine Uginet-Chapot, arrière-arrière-petite-fille de Claude Cohendet-Chapot. |
|
En définitive, par
l'ensemble de ses propriétés, Claude Cohendet-Chapot appartenait à
la catégorie des petits propriétaires. Tant par la surface
possédée, que par la diversité des types de terres, il pouvait
assurer la subsistance alimentaire de sa famille, sans qu'il lui soit
nécessaire ni d'acheter des denrées alimentaires, ni de vendre sa
force de travail pour se créer un revenu. Notons d'ailleurs qu'il
procurait à sa famille une certaine variété alimentaire :
céréales, féculents (châtaignes), fruits, légumes, viandes et
salaisons, vin. Il disposait aussi des matériaux de base pour
couvrir ses maisons, avec la paille de seigle pour faire le chaume,
et le bois pour se chauffer, faire la cuisine et construire les
quelques meubles qu'il possédait. Il devait tout de même être
obligé de vendre une partie de sa production pour disposer d'un peu
de liquidité pour payer les taxes et impôts, pour acheter les biens
qu'il ne pouvait pas fabriquer (ustensiles de cuisine et outils
agricoles) et pour compléter son patrimoine par des achats de
terres.
Dernière remarque sur
ce très riche inventaire, si on se donne la peine d'en relever tous
les détails. Le notaire précise que seules trois parcelles sont
ensemencées en seigle, soit une surface de 72 ares. Le seigle se
sème en automne. En revanche, l'ensemencement en orge n'a pas
encore été fait, puisque Claude Cohendet-Chapot a 20 litres d'orge
précieusement conservés au grenier pour cela. L'orge se plante au
printemps.
Pour revenir aux terres
possédées par Claude Cohendet Chapot : les parcelles 224 et 222 et
la grange, la comparaison entre le cadastre de 1732, celui de
1873 (premier cadastre établi après l'annexion de la Savoie à la
France) et le cadastre actuel montre une permanence du découpage des
parcelles sur une durée de presque 300 ans. La seule différence est
que les deux parcelles, ainsi que la grange ont été scindées en
deux parts égales. C'est très probablement le résultat d'un
partage entre les enfants de Claude Cohendet-Chapot, ou entre 2
frères d'une génération postérieure. L'usage de couper les
parcelles de même nature en deux s'explique par cette volonté de
conserver la diversité des terres, pour les différents usages
agricoles nécessaire à l'impératif de subsistance. Dans le cas de
Claude Cohendet-Chapot, une division de son patrimoine en 2 parts
égales pouvait conduire à disposer d'une surface totale trop faible
par rapport au minimum nécessaire pour assure la subsistance d'une
famille. Pour cela, il était donc impératif de se marier avec une
jeune fille de niveau social équivalent afin que sa dot compense la
perte due à cet usage des partages en parts égales.
 |
| Comparaison des parcelles 224 et 222 et de la grange de Claude Cohendet-Chapot entre la « mappe » de 1732, le cadastre de 1873 et le cadastre actuel. |
Après le décès de Claude Cohendet-Chapot, sa veuve, Anne Deschamps-Bonnat s'est remariée en 1749 avec Jean Baptiste Duc, maître cordier, de la Plaine de Conflans. Nous ne savons ni quand ni où elle est décédée. Elle vivait encore en 1764. Sa fille aînée, Claudine Cohendet-Chapot, a épousé Joseph Jaquin (ou Jacquin) de Venthon le 1er août 1763. Nous descendons de ce couple. Le fils Joseph Cohendet-Chapot s'est marié vers 1775 à Paris avec Françoise Ursule Favre-Donnier, une Savoyarde de Paris. Ils ont fait souche à Venthon où l'usage a prévalu de les nommer simplement Chapot. Le témoin du décès de Joséphine Uginet-Chapot, veuve Barféty, en 1905, Donat Chapot, est un descendant de couple.
Le document numérisé est accessible sur le site des Archives départementales de Savoie, bureau du tabellion de Conflans, registre d'insinuation 02/01/1741-04/04/1741 (2C 1487), vues 279-283/585 :
cliquez-ici.
Ce travail d'études et de recherche d'Andrée Vibert-Guigue, professeure d'histoire, paru en 1973 :
La vie rurale à Saint-Maxime de Beaufort dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est une source précieuse d'informations et de comparaisons pour l'analyse de cet inventaire. Beaufort-sur-Doron se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Venthon, au centre du Beaufortain :
Comme à Venthon, la propriété est très morcelée et les parcelles sont en général petites. A Beaufort, 22 % des propriétaires possèdent entre 2,5 et 5 hectares, comme Claude Cohendet-Chapot. 57 % possèdent moins de 2,5 ha. et 21 % plus de 5 hectares. On voit donc, par comparaison, qu'il se situe dans la moyenne supérieure des propriétaires, le classant parmi la moyenne paysannerie.
A propos du mobilier, elle donne une synthèse fondée sur l'exploitation des inventaires après décès :
Les meubles, fabriqués le plus souvent
par le paysan lui-même, visent à satisfaire les besoins
élémentaires des habitants.
Les bois de lit figurent dans tous les
inventaires sans exception. En général, chaque famille en possède
au moins deux. Isolés du reste de la chambre par des rideaux, ces
lits ne sont pas très confortables. Deux familles seulement
détiennent des matelas de laine ou de grains ainsi que des
paillasses. Les gens dorment sans doute directement sur le foin. Les
traversins et couvre-lits demeurent très rares. On les trouve
seulement chez les personnes aisées. Draps et couvertures par contre
abondent, Ces dernières très chaudes sont fabriquées sur place
grâce à la laine des moutons. Les peaux de ces animaux ainsi que
celles des chèvres sont utilisées comme couverture l'hiver
lorsqu'il fait bien froid. Dans chaque foyer, deux ou trois coffres
contiennent les linges et vêtements de chacun. Munis d'une serrure,
ils sont toujours soigneusement fermés à clef. [..]. Les tables,
quelquefois rondes, mais le plus souvent rectangulaires, sont assez
répandues. Comme tous les meubles d'ailleurs, elles se fabriquent en
bois sapin, quelques unes peuvent être en noyer. Les chaises
n'apparaissent qu'en 1780 ; pour s'asseoir les gens utilisent des
tabourets et surtout de longs bancs. Ceux-ci sont disposés de façon
à ce que leurs occupants bénéficient de la chaleur procurée par
la cheminée. Les poêles n'existent pas et le seul moyen de
chauffage est constitué par cette cheminée. A l'intérieur de
celle-ci, la crémaillère attachée à un anneau, permet d'accrocher
au-dessus du feu un chaudron en cuivre où l'eau chauffe en
permanence. Les paysans possèdent au moins trois ou quatre de ces
récipients. Ils sont de dimension variable, les plus gros pèsent
dix kilos, les plus petits, un kilo et demi. L'eau est transportée,
de la fontaine proche, à l'aide de bassins en cuivre ou de seaux en
bois. La cuisine se fait sur l'âtre, en avant du feu, en profitant
de la proximité de la flamme, grâce à des pots de fer. Ils sont
eux aussi de dimension variable [...] Ils disposent également de
marmites ou brons en fer ou fonte dans lesquelles ils font cuire la
soupe.
Les ustensiles de ménage se révèlent
assez nombreux. Les poêles à frire figurent dans tous les
inventaires, ainsi que les écumoires et les grandes fourchettes de
fer servant à saisir les légumes ou la viande. Couteaux à hacher,
saladiers, terrines, salières, moutardiers et moulins à poivre,
sont la propriété de personnages plus aisés.
Les pauvres comme les riches disposent
pour manger de plats, d'assiettes, d'écuelles et cuillères en étain
ou bois, qu'ils rangent soigneusement le repas fini dans le
"rattelier" prévu à cet effet. La vaisselle de faïence
existe, mais elle est un luxe réservé aux notaires et aux prêtres
de Saint-Maxime. Chez ces notables, on peut aussi trouver des
gobelets de verre et des tasses à café avec leurs soucoupes. Si les
cuillères d'étain sont très répandues, les fourchettes
exclusivement en fer demeurent encore une exception en 1750 ; en
1780 elles semblent être utilisées presque couramment. Les couteaux
ne sont jamais mentionnés dans les inventaires. Ils ne se révèlent
peut-être guère nécessaire car les paysans consomment, on va le
voir, des aliments qui souvent ne nécessitent pas la présence d'un
couteau.
Cette analyse permet de constater que Claude Cohendet-Chapot et sa famille vivaient dans la moyenne de leurs compatriotes, par l'équipement de leur foyer en mobilier et en ustensiles de cuisine, à l'exception déjà notée de la vaisselle. La frugalité des mœurs était alors partagée par presque tous.
Lien vers la généalogie de Claude Cohendet-Chapot :
cliquez-ici.
Lien de parenté avec ce couple :
cliquez-ici.
Je n'ai pas trouvé de représentation satisfaisante d'un intérieur savoyard au XVIIIe siècle. J'ai donc choisi de terminer ce message avec ce très célèbre tableau de Louis Le Nain : Famille de paysans dans un intérieur, daté des environs de 1642.
Je ne sais pas si la représentation est fidèle. La présence du vin, dans un verre qui détonne un peu par rapport aux autres biens et ustensiles, du pain et du sel peut laisser penser à un message symbolique ou religieux. Il ne faut donc pas y voir une peinture réaliste d'un intérieur paysan, mais, malgré cela, ce tableau m'évoque nos ancêtres paysans dans la simplicité de leur quotidien.
Complément :
A propos du mot « cornue », un lecteur m'a sympathiquement transmis cette information qui me donne une piste pour identifier cet objet :
« La cornue, ou comporte chez nous dans le sud, est un récipient de bois servant a transporter les raisins de la vigne à la cave. Ce nom de cornue vient du fait qu'il est équipé de deux supports ressemblant à des cornes. », avec cette image :